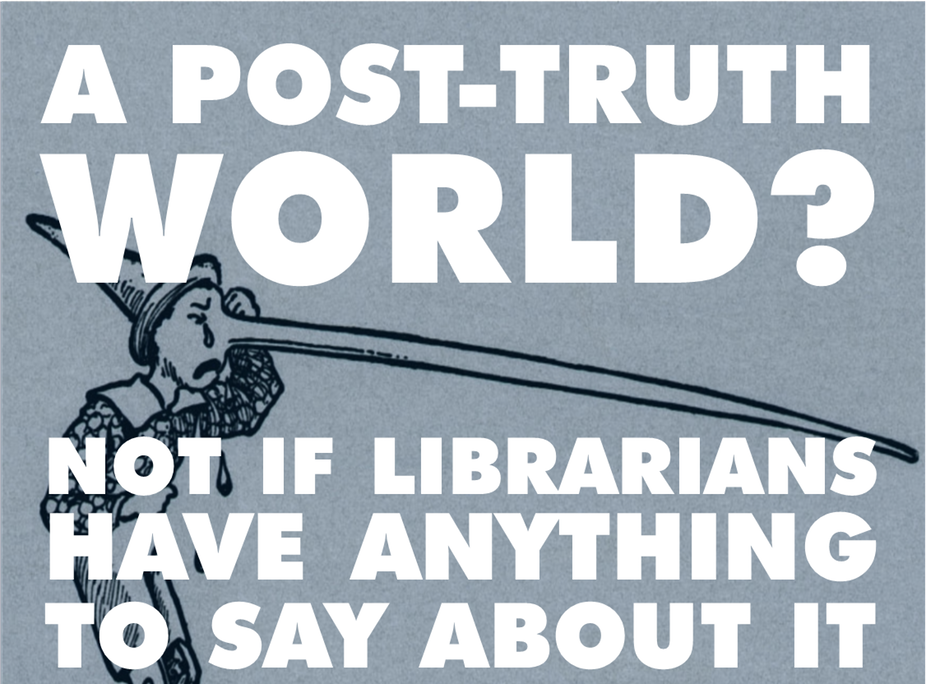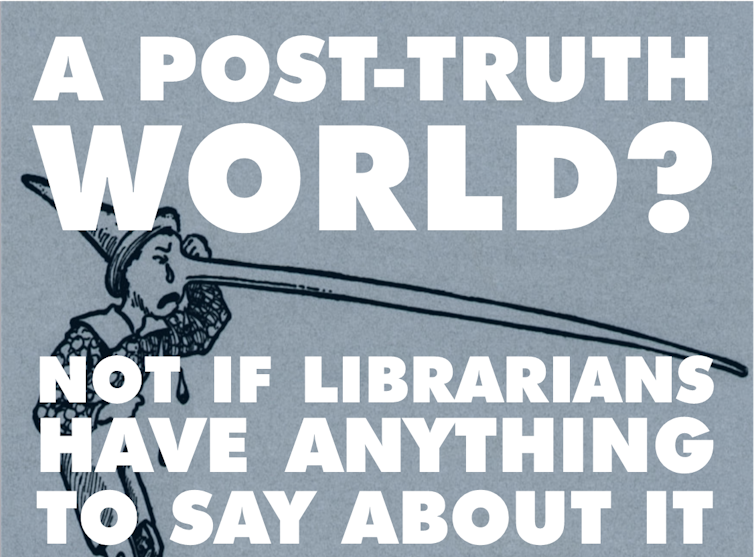
HCPL/Visual Hunt, CC BY-NC-SA
Marcello Vitali-Rosati, Université de Montréal
De fausses nouvelles, il y en a toujours eu. Qu’il s’agisse de canulars, calomnies, propagande, ignorance, tromperie, mensonge, croyance, notre vie sociale regorge d’informations, d’idées, d’affirmations qui ne correspondent pas à la vérité. Pensons à Platon et à son besoin de distinguer l’opinion (doxa) de la vérité : la doxa est toujours assujettie au risque du faux. On pourrait même aller jusqu’à affirmer que le langage lui-même n’existe que pour dire le faux : on dit ce qui n’est pas, car autrement on n’aurait pas besoin de le dire. La vérité se montre toute seule et on n’a recours au langage que pour la dissimuler.
Mais qu’est-ce qui rend alors si particulier ce phénomène actuel que l’on qualifie de « post-vérité » ? Quel est le rôle du web et des médias numériques dans cette apparente explosion des fausses nouvelles qui semble caractériser les dernières années ?
En 2016, en effet, le mot « post-truth » a été choisi comme « mot de l’année » par les Oxford Dictionaries, en raison de la fréquence élevée de son emploi. En particulier, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’élection de Donald Trump aux États-Unis ont été expliquées par plusieurs analystes comme le résultat d’une présence inédite de fausses nouvelles qui ont fortement contribué à manipuler l’opinion publique. Peu après l’élection de Trump, Kellyanne Conway, conseillère du président, utilise l’expression « alternative facts » pour défendre les fausses affirmations de la Maison-Blanche concernant le nombre de participants à la cérémonie d’investiture du président.
De nouveau, le 2 octobre, le New York Times parle d’un regain de force des fake news en relation aux fausses informations circulées à propos de la fusillade de Las Vegas. Ces évènements qui semblent mettre en crise notre rapport à la vérité ont été souvent attribués à l’impact des médias sociaux qui permettent la circulation et la diffusion rapide d’informations non vérifiées.
Pour résumer : les lecteurs sont bombardés de fausses informations sur le web, les réseaux sociaux en augmentent la visibilité si bien que les fausses nouvelles finissent par avoir plus de poids – et plus de crédibilité – que les vraies. Cela détermine une situation où il n’est plus possible de distinguer le vrai du faux, jusqu’à mettre en crise la notion même de vérité.
Le rôle du web
L’idée que les technologies numériques, et plus précisément le web, seraient les responsables d’une telle situation se base sur un présupposé qui me semble profondément faux : le web serait un espace sans règles ni structure où « n’importe qui peut dire n’importe quoi ».
Cette idée n’est pas seulement une vulgata, mais elle est souvent présente aussi dans le discours d’intellectuels qui analysent les changements produits par le numérique. Que l’on pense à l’affirmation d’Umberto Eco, selon lequel
« Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui avant ne pouvaient parler qu’au bar, après un verre de vin, sans conséquence pour la collectivité. On les faisait se taire tout de suite, tandis que maintenant ils ont le même droit de parole qu’un Prix Nobel. »
Outre que dénoter une certaine imbécillité de mon fameux concitoyen – même les érudits peuvent donc être imbéciles –, cette phrase nous révèle quelque chose d’essentiel que je vais essayer d’analyser en ces quelques pages : le rôle de l’institution dans l’établissement de la vérité.
En effet, plutôt que d’opposer un espace sans règles ni structure – le web – à un espace structuré et ordonné – l’espace pré-numérique –, il est nécessaire de comprendre que le web est lui aussi très rigidement organisé. Ce qui pose problème est que son organisation diffère de celle de l’espace pré-numérique, et en particulier de l’espace médiatique pré-numérique.
En d’autres termes, il n’est absolument pas vrai que sur le web tout est sur le même plan et que c’est pour cette raison que l’on ne peut plus distinguer le vrai du faux. Au contraire, sur le web chaque objet, chaque texte, chaque document, chaque information occupent une position et une place bien précise et sont insérés dans une hiérarchie très structurée. Mais cette hiérarchie n’est pas celle de l’espace médiatique pré-numérique.
La question qu’il faut donc se poser est : quelles sont les conditions qui permettent à une information d’avoir plus de crédibilité qu’une autre ?
Autorité, confiance et vérité
Cela revient à se poser la question de l’autorité. Et à y regarder de plus près, c’est justement cette question que soulève Umberto Eco avec toute la vulgarité de sa triste phrase.
Commençons d’abord par donner une rapide définition de l’autorité. On peut se baser sur l’idée d’Hannah Arendt selon laquelle l’autorité est la capacité d’obtenir de l’obéissance sans avoir recours ni à la persuasion ni à la contrainte. En d’autres termes, l’autorité est quelque chose qui inspire confiance : nous croyons à l’autorité non parce qu’on nous démontre qu’elle dit le vrai, ni parce qu’on nous oblige à y croire ; nous croyons à l’autorité parce que nous lui faisons confiance.
Pourquoi, selon Eco, le prix Nobel devrait dire le vrai plus qu’une personne qui boit un verre de vin au bar ? Parce que le prix Nobel est une autorité. Nous faisons confiance au fait que quelqu’un qui a reçu un prix Nobel soit un expert, un savant et soit donc en mesure de nous dire la vérité. Dans toute société il y a une structuration précise et claire de l’autorité qui nous permet de savoir en quoi – et en qui – avoir confiance. On reconnaît toujours les signes de l’autorité. Il existe en effet une organisation d’institutions qui permettent de reconnaître : les États, les Universités, les médias, les maisons d’édition… La vérité n’est possible que grâce à cette organisation : les institutions garantissent des critères de vérité et ont l’autorité pour les faire respecter.
Dans les journaux, par exemple, l’institutionnalisation des critères de vérité est le fruit d’une longue histoire et d’un ensemble de critères : les lois, les déontologies professionnelles, de longues négociations du rapport de confiance avec les lecteurs, une position particulière dans une certaine société… permettent à un journal d’avoir d’une part des critères de vérité clairs et stables et d’autre part de gagner de l’autorité.
Autorités numériques
La rapide diffusion du web a quelque peu bouleversé ces institutions en produisant de nouveaux dispositifs d’autorité. Si l’on prend en considération de manière superficielle ce qui s’est produit, on est porté à croire qu’il n’y a plus d’autorité, que tout est sur le même plan. Mais à un regard plus attentif, il est facile de réaliser que c’est le contraire qui est vrai. Les plus grands acteurs du web sont justement ceux qui arrivent à produire confiance et autorité.
On pourrait même dire que ces grandes entreprises vendent de l’autorité. Le web est une énorme machine de production de l’autorité. Pensons à l’autorité que nous accordons à Google search : 99 % des usagers ne vont jamais au-delà de la première page de résultats. Cela signifie que nous considérons que Google search nous dit la vérité : ses premières réponses sont les bonnes.
La confiance que nous accordons à de plateformes comme Facebook, Wikipédia, Amazon… nous montre qu’il n’est absolument pas vrai que tout est sur le même plan. Une information qui est présente sur les murs Facebook d’un million d’usagers n’est pas sur le même plan qu’une information qui n’est sur aucun de ces murs ; un livre qui apparaît sur la page d’accueil d’Amazon pour un million d’usagers n’est pas sur le même plan qu’un livre qui n’y apparaît pas. Un blogue qui est listé en premier dans une recherche sur Google search a une position complètement différente par rapport à un blogue qui n’est pas indexé.
La question est de comprendre comment l’agencement institutionnel qui permettait la production de l’autorité dans le monde pré-numérique est en train d’être restructuré. Les équilibres changent et en effet, le fait d’avoir reçu un prix Nobel, d’avoir été publié par une grande maison d’édition et d’avoir fait la une d’un quotidien important ne sont plus les seuls paramètres pour acquérir de l’autorité.
Il y a désormais d’autres dispositifs de production de l’autorité et la position que l’on occupe dans l’espace numérique en est l’un des plus importants. Cela ne veut pas dire que les autorités pré-numériques n’ont plus un rôle fondamental à jouer. Dans l’espace numérique, les autorités traditionnelles continuent d’exister : le site web d’un gouvernement a plus d’autorité que celui d’un groupe privé, l’affirmation d’un prix Nobel a plus de poids que celle d’un inconnu. Mais il y a désormais d’autres dispositifs qui produisent de la confiance et de l’autorité en parallèle – voire en concurrence – des anciens.
Que faire ?
Au lieu de crier au scandale, les institutions doivent essayer de comprendre ces mécanismes et tenter d’en devenir les protagonistes. Il me semble que la question principale à se poser est celle de l’espace public. Un des problèmes fondamentaux des dispositifs de production de l’autorité sur le web est que la quasi-totalité d’entre eux est privée. Faire confiance à quelqu’un parce qu’il détient un diplôme universitaire signifie faire confiance – au moins dans des États où l’université est publique – à une institution qui appartient à la collectivité.
Ses choix et sa façon de déterminer des critères de vérité – par exemple des méthodologies de recherche – sont négociés de façon publique. Sur le web, à part quelques exceptions comme Wikipédia, l’autorité est concentrée dans les mains de quelques entreprises et ce sont ces entreprises qui ont le bénéfice d’établir des critères de vérité comme bon leur semble.
Lors de l’élection de Trump, Zuckenberg a essayé de mettre en place des systèmes pour limiter la circulation de fausses nouvelles sur Facebook : de cette manière, il revendique le rôle institutionnel de Facebook qui détient une forte autorité, et il affirme sa responsabilité dans la définition des critères de vérité.
Je ne vois rien de mal, en soi, à cette situation. Un acteur privé qui a de l’autorité – comme peut l’être aussi un quotidien, par exemple – se trouve face à une crise de la véridicité des informations qu’il contribue à faire circuler – comme cela pouvait arriver aussi à un quotidien classique. Il décide donc d’agir pour rendre plus fiables ses critères de vérité – comme l’aurait fait un quotidien désireux de récupérer la confiance de ses lecteurs.
Le problème n’est donc pas tellement le fait que Facebook ait de l’autorité, mais plutôt qu’il y ait si peu d’autres institutions capables de produire de l’autorité en ligne – laquelle se retrouve, par conséquent, excessivement centralisée. Certains auteurs (comme Morozov ou Sadin) considèrent qu’il est impossible de contrer ce phénomène, mais il me semble que des expériences comme Wikipédia montrent le contraire. Wikipédia est parvenue à s’ériger en autorité tout en négociant collectivement, de façon ouverte et publique, ses critères de vérité. Et l’impact de cette expérience est tout à fait comparable à celui des grandes entreprises du web.
Le succès de Wikipédia est justement basé sur sa capacité à mettre en place un dispositif d’évaluation et de vérification fortement structuré et adapté aux structures de l’espace numérique. Certes ce ne sont pas – ou pas principalement – des prix Nobel qui écrivent les articles, mais les dispositifs de validation des informations sont assez bien structurés et stabilisés pour que l’on puisse faire confiance à Wikipédia autant qu’à l’académie des Nobel.
Wikipédia reste un cas plutôt isolé. Mais le web pullule d’initiatives qui permettent ainsi de négocier des critères de vérité et de produire de l’information de qualité.
Si nous voulons faire quelque chose pour contrer l’explosion des fausses nouvelles, nous devons d’abord comprendre les mécanismes de production de la confiance en ligne et ensuite essayer d’investir cet espace afin de produire des modèles différents de ceux des grandes entreprises du web. Les médias traditionnels peuvent et doivent le faire s’ils veulent survivre.
Des initiatives comme le fact checking me semblent des plus heureuses : mettre à disposition des lecteurs les sources en utilisant des hyperliens est une pratique simple et adaptée à l’environnement numérique. Le plus de liens seront présents dans une information, le plus elle sera auto-vérifiable.
![]() Toute attitude paternaliste et méprisante face à l’espace numérique me semble destinée à l’échec – outre qu’au ridicule. Le web et les environnements numériques en général sont devenus désormais notre principal espace de vie : il est donc fondamental de créer des lieux où l’on puisse négocier de façon collective et publique les critères de vérité.
Toute attitude paternaliste et méprisante face à l’espace numérique me semble destinée à l’échec – outre qu’au ridicule. Le web et les environnements numériques en général sont devenus désormais notre principal espace de vie : il est donc fondamental de créer des lieux où l’on puisse négocier de façon collective et publique les critères de vérité.
Marcello Vitali-Rosati, Professeur agrégé au département des littératures de langue française, Université de Montréal
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.